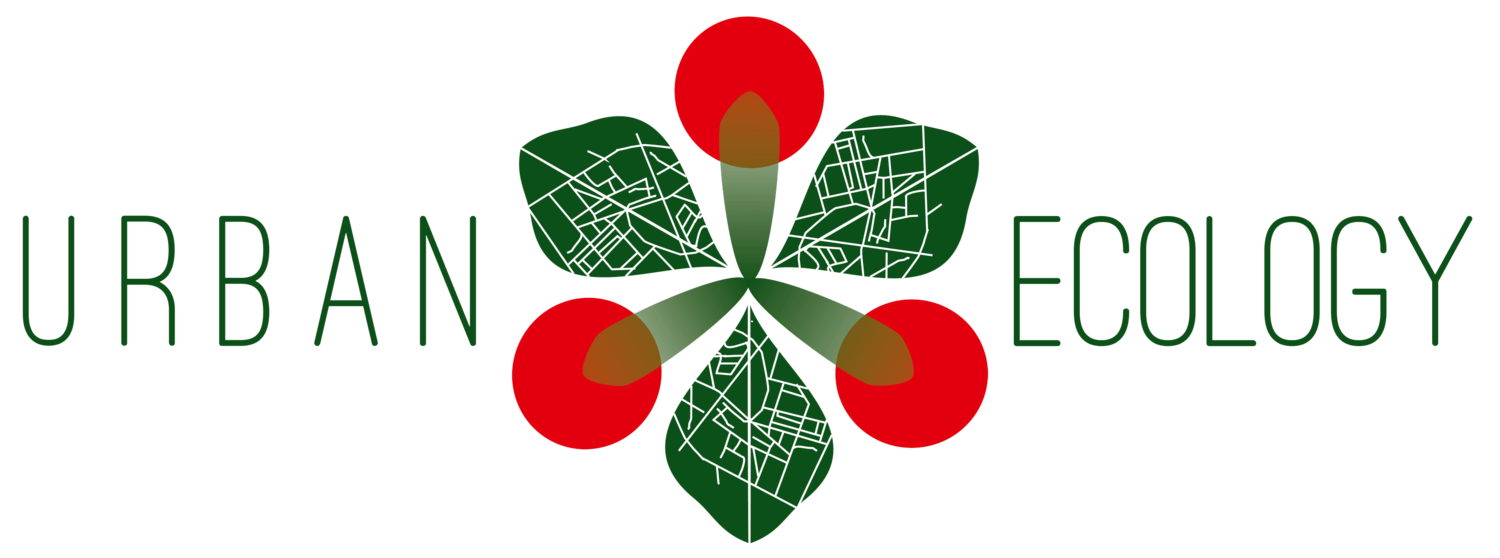2016. Agriculture urbaine : utopie par-delà ville et campagne ?
Sous la bannière de l’ « agriculture urbaine » se regroupent un ensemble de projets et d’initiatives qui, bien que fort différents, poursuivent une même vision : celle de rendre la ville plus autonome et plus résiliente en y intégrant des activités du secteur primaire de l’économie. Sans même poser les questions techniques qui stimulent par exemple l’ingéniosité et l’imaginaire de nombreux esprits créatifs – agriculture verticale, toits végétales, aquaponie –, cet article soutient que malgré les bouleversements économiques des XIXe et XXe siècles qui ont fait tomber à moins de 3 % la part des agriculteurs dans la population active belge (Chiffres clés de l’agriculture, 2015) ; Rapport national de Belgique, 2009), la distinction de la ville et de la campagne a encore du sens si l’on veut que l’agriculture et la ville dialoguent et s’articulent de manière constructive.
Dans un premier temps, cet article met en évidence la fausse analogie entre l’agriculture urbaine et l’agriculture « classique ». Dans un deuxième temps, on propose une redéfinition de l’agriculture urbaine dans les champs de l’éthique et de l’esthétique permettant de faire une série de recommandations pour son développement et son intégration aux grands enjeux des villes, comme par exemple la gestion de ses matières organiques.
INTRODUCTION
Alors que les agriculteurs représentaient en Belgique plus de la moitié de la population en 1850, ils ne sont plus que 8% en 1980, et moins de 2% aujourd’hui (Chiffres clés de l’agriculture, 2015) ; Rapport national de Belgique, 2009). Avec la révolution industrielle et le développement des transports, les villes se sont étalées et les campagnes vidées. L’usage généralisé de la voiture a fini de gommer les différences de modes de vie entre la ville et la campagne créant de plus en plus de zones hybrides appelées péri-urbaines et, parfois, « rurbaines ». En 150 ans, la vie paysanne a presque entièrement disparu. Ce qui peut en subsister alimente aujourd’hui un imaginaire urbain fécond qui refuse de plus en plus les déviances d’un système agricole hyper-productiviste qui érode les sols (Montgomery, 2007), ruine la biodiversité (Le Roux X.), pollue les nappes phréatiques et maltraite les animaux. Mais les tendances sont lourdes. Le nombre d’agriculteurs continue de baisser et il est toujours de plus en plus difficile pour un jeune agriculteur sans capital d’accéder aux terres qui disparaissent sous les assauts de l’urbanisation.
D’un autre côté, en ville, la tertiarisation de l’économie et la désindustrialisation ont ouvert de nouveaux espaces à conquérir. Conscient des enjeux écologiques que l’ère de l’anthropocène représente, des millions de citadins à travers le monde ont donc entrepris de cultiver dans tous les interstices de la ville. Tantôt par passion de mettre les mains dans la terre, tantôt par nécessité économique, l’« agriculture urbaine » s’est répandue comme une trainée de poudre, encouragée par les politiques de revitalisation urbaine qui y voient un énorme potentiel de développement social. Dans la littérature scientifique et grise, l’agriculture urbaine est ainsi plébiscitée pour permettre de réguler les microclimats urbains, tisser du lien social et renforcer les collectivités, contribuer à une meilleur santé physique et mentale au travers par exemple d’une meilleure alimentation, éduquer et informer sur le fonctionnement complexe des écosystèmes ou encore pour créer des circuits courts d’approvisionnement en diminuant les transports (Lovell, 2010).
L’intérêt grandissant pour l’agriculture urbaine a conduit le Ministère bruxelloise de l’Environnement, de la Qualité de Vie et de l’Agriculture à lancer la stratégie Good Food pour promouvoir une alimentation durable et atteindre 30% de production locale à l’horizon 2020. Si les projets se heurtent bien sûr à la croissance démographique, au prix du foncier et à la qualité médiocre des sols, qu’à cela ne tienne : on cultivera sur les toits comme à la Bibliothèque Royale. Dans l’effervescence des idées et des projets, une première édition de l’Ecole d’Été de l’Agriculture Urbaine s’est également tenue en juillet 2016 à l’Université Libre de Bruxelles, regroupant plusieurs centaines de participants académiques, associatifs et citoyens.
Le terme d’ « agriculture urbaine » reste cependant très polysémique. Stricto sensu, l’agriculture est la culture du champ – ager en latin – alors qu’il est en réalité le plus souvent question de jardins urbains, donc d’horticulture – hortos en latin – qui comprend notamment le maraîchage et les pépinière. L’expression « agriculture urbaine » est donc souvent malheureuse. Cependant, des auteurs comme Donadieu et Fleury (voir bibliographie) l’utilisent pour désigner l’agriculture péri-urbaine où les espaces agricoles sous très fortement soumis à l’influence urbaine. Cet article distingue toujours agriculture « urbaine » et « péri-urbaine ».
Quoi qu’il en soit, l’expression est devenue le cri de ralliement d’un ensemble de projets et d’initiatives qui, du potager à l’aquaponie en passant par la champignonnière, poursuivent une même vision : celle de rendre la ville plus autonome et plus résiliente. Mais alors que la perspective d’une ville auto-suffisante débride l’imagination des designers et des architectes qui se mettent à dessiner des fermes verticales, on en oublierait presque la situation actuelle d’une ville entièrement dépendante. Et cela pour tout. Bruxelles-Capitale tire la quasi-totalité de son énergie, de son eau et se son alimentation d’autres territoires, des plus proches – les zones péri-urbaines – aux plus lointains – l’autre bout du monde. L’agriculture urbaine peut-elle prétendre changer cet état de fait ?
METTONS LA VILLE À LA CAMPAGNE, L’AIR Y EST PLUS PUR [1]
En matière de ressources primaires, la ville dépend de manière constitutive de ces territoires (Fleury et Vidal, 2010). La ville naît en fait des surplus de production de l’agriculture. Selon Pierre Lavedan (1936), la ville est ainsi avant tout le lieu où se tient le marché, voire la bourse, ainsi que les institutions. Dans le roman la Terre de Zola, les paysans français de la Beauce du milieu du XIXe siècle se rendent à la ville la plus proche pour acheter et vendre sur le marché, pour légaliser des décisions chez le notaire, pour aller à l’église. Par extension, la ville est donc le point de l’enracinement des institutions économiques, politiques et religieuses. La ville a donc d’abord comme particularité de concentrer les pouvoirs (Duby, 1981). Elle est donc un lieu d’émulation sociale et intellectuelle. Pour Pierre Lavedan, la ville est l’endroit où l’homme agit si collectivement qu’il parvient à dominer la nature et à « échapper à son milieu physique ». Pour ce faire, il s’enferme dans des carcans de lois très strictes.
Par opposition à la ville, la campagne est le lieu du travail de la terre, donc de l’agriculture à proprement parler, c’est-à-dire du travail des champs – du latin ager, le champ, et cultura – travail de l’homme. Si la campagne ou la ruralité pourraient se définir comme l’espace où l’homme est tributaire des saisons et des intempéries pour sa survie et sa prospérité, elle est aussi l’espace qui est dépendant de la ville qui achète ses récoltes et lève les impôts.
C’est aussi en matière de revalorisation des déchets que la ville et la campagne ont toujours entretenu des relations d’interdépendance. Dès le moyen-âge, de véritables conventions liaient les agriculteurs et les maraîchers à la ville. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’agriculture récupérait l’ensemble des déchets produits par la ville (Kohlbrenner, 2014 ; Fleury & Vidal, 2010).
Mais aujourd’hui, en Belgique, alors que les agriculteurs ne représentent guère plus de 2% de la population et que les déchets organiques sont brûlés ou traités avant d’être rejetés dans les cours d’eau naturels, ce contraste de la ville et de la campagne a perdu de sa vigueur. La disparition de la paysannerie et l’avènement de l’agriculture intensive a de toute évidence bouleversé la culture au sens d’un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir (Rocher, 1968). Dans ce contexte, doit-on considérer l’agriculture urbaine comme le début d’un renouveau agricole ou, c’est notre hypothèse, comme l’expression d’une nouvelle éthique et d’une nouvelle culture en partie hantée par les images d’un monde paysan perdu ?
Pour répondre clairement à cette question nous avons d’abord comparé l’agriculture « classique » et l’agriculture urbaine d’après quatre critères : (1) Économique et commercial, (2) Social et professionnel, (3) Compétence et connaissance, (3) Normes et prescriptions.
Dans un second temps, d’après l’évidence que le rapprochement entre agriculture urbaine et classique relève d’une fausse analogie, cet article suggère qu’une définition de l’agriculture urbaine dans le champ de la culture, de l’éthique et de l’esthétique permettrait de mieux la concevoir et ainsi d’améliorer le dialogue entre les citadins et les agriculteurs.
I. L’AGRICULTURE « CLASSIQUE » / L’AGRICULTURE URBAINE
Au travers de ses nombreux modèles – culture sur les toits, potagers, aquaponie, hydroponie, champignonnière, « spin farming » etc – l’agriculture urbaine est productive. Néanmoins, ses bénéfices économiques proviennent essentiellement des jardins collectifs qui revêtent une fonction largement sociale en offrant des services non-marchands (Wolf-Powers, 2014). C’est d’ailleurs souvent à ce titre que les projets sont subsidiés.
Dans leur rapport sur la viabilité des business modèles en agriculture urbaine dans les Pays du Nord, Chapelle & Jolly de Greenloop (2013) concluent très clairement que les acteurs vivant uniquement de leur production sont rares, que l’apport du bénévolat reste crucial et, enfin, que l’intervention des pouvoirs publics est le plus souvent liée aux autres services rendus à la collectivité. A Bruxelles, ce fut par exemple le cas de l’expérience du projet « Potage-Toit » sur les toits de la Bibliothèque Royale qui a fonctionné sur une base de bénévolat défrayé, doublée de subventions pour sa mise en place.
S’il existe des projets commerciaux tels que par exemple les Fermes Lufas à Montréal ou les Gotham Greens Farms à New York qui produisent dans des immenses serres sur les toits de quoi approvisionner des ménages et de grands restaurants au cœur de la ville, les réalités économiques auxquelles ils font face sont difficiles. Dans un article paru le 13 avril 2016 dans le Wall Street Journal, le journaliste Ruth Simon explique qu’ils ont été contraints de licencier du personnel, automatiser et sélectionner un nombre très réduit de variétés adaptées à ces environnements artificiels particuliers. En février 2016 par exemple, l’entreprise FarmedHere a abandonné l’aquaponie jugée trop compliqué et non-rentable. Au bout de la chaîne de production, enfin, les produits sont significativement plus chers et sont marketés auprès d’une population plus aisée prête à payer pour des produits « locaux et bio » (Wolf-Powers, 2014).
A moins de parler d’agriculture péri-urbaine qui pose la question de l’intégration du métier d’agriculteur à la culture urbaine, il n’existe pas à proprement d’agriculteur urbain. Ces derniers ne forment pas de catégorie sociale-professionnelle. Les acteurs et leurs luttes n’ont ainsi presque rien en commun puisque l’objet sur lequel ils portent n’est pas le même. En effet, les uns reconvertissent des espaces urbains délaissés par les transformations de l’économie au travers de projet souvent précaires (Knapp & Co, 2015), les autres cultivent des terres agricoles au travers des générations.
En région de Bruxelles-Capitale, les projets SPIN et Cycle Farm qui proposent de développer un modèle de micro-agriculture et de micro-fermes, proposent de notre point de vue des modèles d’horticulture en partie péri-urbaine.
Un autre projet comme « Ultra Tree » du Centre d’Étude Économique et Sociale de l’Environnement de l’ULB qui s’intéresse à la viabilité des modèles agricoles sur petite surface porte essentiellement sur l’agriculture péri-urbaine (par exemple à Nerpeede).
L’agriculture urbaine est toujours une horticulture, du latin hortos, le jardin. Pour l’Académie Française, l’horticulture est un art ouvert à tous. Au contraire, l’agriculture est la culture des champs – ager en latin – encadrée par une science : l’agronomie.
L’agriculture est encadrée et régulée par des lois et des règles explicites formant le droit rural ou agricole. En 2014 par exemple, la Wallonie s’est dotée du premier code Wallon de l’agriculture. En revanche, l’agriculture urbaine est profondément marquée par des principes éthiques. C’est le cas par exemple de la « permaculture » qui est une technique de maraîchage doublée de principes d’inspiration morale à la base du fonctionnement des communautés d’usagers. Ces principes fondamentaux sont : (1) prendre soin de l’humain, (2) prendre soin de la terre et (3) partager équitablement.
D’après cette comparaison, on peut affirmer que l’agriculture urbaine et l’agriculture n’ont presque rien en commun. Le fait que des projets d’agriculture se trouvent parfois très près de la ville ne remet pas en cause cela : il s’agit alors d’agriculture péri-urbaine. S’il peut arriver que des champs cultivés se retrouvent encerclés du fait de l’étalement urbain, c’est que ses zones sont en périphérie de la ville, jamais en son centre où l’on trouve plutôt l’église, la place du marché et la Commune.
Enfin, si de nombreuses initiatives productives existent historiquement à l’intérieur des villes, il s’agit toujours d’horticulture – du latin hortos, le jardin – dont les pépinières et le maraîchage en pleine terre ou sur les toits font partie. A moins donc de confondre le jardin et le champ, l’hortos et l’ager, le terme d’agriculture urbaine réfère à autre chose qu’à l’agriculture. Mais à quoi ?
II. VERS UNE NOUVELLE CULTURE URBAINE
LA RÉSILIENCE COMME TECHNIQUE DE SOI
L’ « agriculture urbaine » est ainsi désignée du fait d’une fausse analogie avec l’agriculture. A moins que l’on parle d’agriculture péri-urbaine – donc déjà en-dehors de la ville – comme c’est le cas par exemple de Neerpede à Bruxelles, la dépendance alimentaire des villes diminuera peu du fait de l’agriculture urbaine car celle-ci est commercialement peu viable, non-marchande pour des ménages précarisés ou des citadins passionnés, et territorialement instable du fait de la pression foncière, de la pollution et des nombreuses fonctions en concurrence sur les terrains potentiellement disponibles. Car à moins d’instabilités géopolitiques majeures telles que lors de la seconde guerre mondiale où l’on a vu par exemple des bruxellois cultiver le parc du Cinquantenaire, les parcs et les jardins de la ville développent de nombreuses fonctions (récréative, éducative, écologique) avant de produire de quoi nourrir la population
La notion d’agriculture urbaine repose en fait sur un autre raisonnement qu’économique et productif : l’agriculture urbaine veut produire de la résilience, c’est-à-dire la capacité pour un système à s’adapter à des changements plus ou moins brusque en conservant ses fonctions essentielles. Cet objectif de créer de la résilience est par exemple à la base du mouvement des villes en transition théorisé par Rob Hopkins qui n’hésite jamais à imaginer le pire des scénarios, tout comme les belges Raphaël Stevens et Pablo Servigne qui ont co-écrit le livre Comment tout peut s’effondrer. On voit bien que dans ce contexte marqué de pessimisme quant à la possibilité d’éviter les effets négatifs des récents développements de l’espèce humaine, un tournant adaptatif s’opère à tous les niveaux – individuel, collectif, institutionnel (Felli, 2014).
Cette bifurcation vire donc à la dimension éthique. « La promotion de l’adaptation correspond à la production d’une éthique nouvelle centrée sur la transformation des perceptions, des attitudes et des comportements des populations considérées comme vulnérables » ( Felli, 2014). Cette éthique est cependant à double tranchant : elle permet d’un côté un changement des habitudes et des actions à l’échelle d’un individu ou d’un collectif, mais elle peut d’un autre côté tout à fait ignorer les rapports économiques et sociaux qui sont la cause réelle des bouleversements. L’éthique comme technique de soi peut donc absolument ne pas contribuer à changer de modèle, elle peut même contribuer à l’assister. Cela peut-être par exemple la cas d’un individu qui, cultivant un luxuriant jardin au cœur de la ville, ne s’intéresse pas au niveau structurel à la disparition des terres agricoles en Belgique ou à la gestion des déchets à l’échelle de la ville.
DE LA CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE À UNE ÉTHIQUE PRAGMATIQUE
La vue et la prise de conscience d’une planète finie flottant dans l’univers dont l’espèce humaine dépend physiquement pour sa survie et la multiplication des constats alarmants ont forcé l’émergence dans les pays les plus riches d’une conscience environnementale nouvelle remettant en cause les principales traditions de la philosophie morales (Blanc, 2008). Une fois les besoins primaires satisfaits, se développe naturellement des besoins éthiques ou moraux. Comme l’a écrit prosaïquement Brecht (1928) : « d’abord la bouffe, ensuite la morale » [2]. L’éthique est la base d’un engagement et d’une mobilisation individuelle et collective pour modifier des valeurs et des habitudes, mais aussi des représentations, c’est-à-dire une sensibilité esthétique particulière (Gravouil, 2011).
Le besoin éthique s’exprime de nombreuses manières : le type de consommation, le don matériel, le bénévolat. Il semble même que ce besoin croisse à mesure que, au contraire, les scandales et les immoralités du système de production s’accumulent. Arrivé au point où l’intégrité du vivant est remise en cause, l’individu et le groupe ne peuvent plus se contenter de simple choix, et décident de passer à des actions. La permaculture illustre tout à fait cette recherche morale (et) pragmatique. En effet, il s’agit d’une technique de maraîchage doublée de principes éthiques. Cette forme d’éthique très aboutie poursuit l’adéquation des valeurs de l’individu et de son action dans le monde, résolvant du moins en partie la dissonance cognitive qu’induit le fait de devoir vivre moralement en dépendant d’un système que l’on considère comme largement immoral.
DE L’ÉTHIQUE À LA (A)POLITIQUE
Le potentiel de l’agriculture urbaine doit ainsi être conçu sur un autre paradigme qu’uniquement économique et social. L’agriculture urbaine est une éthique et une esthétique, c’est-à-dire un mode d’agir et de vivre. En ce sens, l’« agriculture urbaine » est avant tout une démarche empirique et pragmatique qui s’inscrit dans une vaste dynamique de changement culturel, que l’on définit comme un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir (Rocher, 1968). Qu’il s’agisse des potagers et des composts collectifs, du souci de la biodiversité ou de l’effort général pour protéger la nature et la qualité de la vie en ville, l’enjeu est autant d’agir collectivement en faveur d’un bien commun que d’expérimenter une nouvelle esthétique ouverte aux dynamiques du vivant et aux cinq sens.
Si l’on peut espérer que ce changement proprement culturel trouve à s’épanouir dans les jardins et les parcs (les fameux « espaces verts ») en privilégiant les dynamiques et les fonctions plutôt que la forme et la couleur (Clément, 1997) comme c’est le cas aujourd’hui, un pas dans le bon sens serait fait. Pourtant, ces choix éthiques et esthétiques parfois motivés par le souci de devenir plus résilient, ne devraient pas prioriser les fonctions uniquement productives assurées par l’agriculture ni ignorer les niveaux plus hauts d’action et de décision politique capable d’articuler structurellement les relations de la ville et de la campagne.
A titre d’exemple, Nicolas Vereecken de la Chaire d’agro-écologie de l’ULB nous explique dans un entretien radiophonique [3] que l’apiculture en ville, lorsqu’elle n’est pas pensée en tant que sous-système d’un système plus grand, est une fausse bonne solution. En effet, le discours alarmiste des médias expliquant que les abeilles disparaissent du fait de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture intensive – ce qui est vrai – a conduit les citadins à multiplier les ruches en ville, alors même que la nourriture y manque. Le résultat est que les abeilles sauvages plus discrètes et ne produisant pas de miel, rentrent en compétition avec les abeilles domestiques vivant dans ces ruches. Les abeilles sauvages risquent alors de disparaître avec les fleurs qu’elles seules pollinisent. Si l’opération est productive en termes de miel, elle peut se révéler être contre-productive en termes de services écologiques.
L’exemple montre qu’un problème structurel que sont les pratiques agricoles et la disparition des abeilles se résout illusoirement au travers de l’émergence de nouvelles pratiques urbaines motivées par des considérations éthiques qui peuvent en réalité être contre-productives. Ignorant la complexité structurelle qu’il est très incertain de pouvoir changer, l’éthique est une porte de sortie qui représente, en plus, un marché potentiel. Il peut s’agir de payer plus cher pour consommer un produit labellisé bio ou des légumes locaux produits sur les toits de la ville. Dans le cas des abeilles, de grandes entreprises payent pour redorer leur blason et adapter des stratégies de management de leur personnel en installant des ruches sur leurs toits. Au final, si les techniques de production à l’intérieur de la ville sont intéressantes culturellement et socialement, elles le sont beaucoup moins du point de vue des services écologiques (Ore et Kampelman, 2014) qui préféreraient des écosystèmes simplement non exploités par l’homme.
Enfin, si la résilience que vise l’agriculture urbaine met en œuvre des stratégies individuelles ou collectives en dehors d’une structure politique et de toute sécurité sociale (Felli, 2014), le risque est grand que les initiatives d’agriculture urbaine demeurent en dehors de tout système, donc politiquement anodines et inoffensives pour la machine de production industrielle pourtant responsable des dégradations environnementales. Une piste d’action pour les pouvoirs publics, afin de sortir de cette impasse, est donc de renforcer les liens et les coopérations entre cette nouvelle culture urbaine et les enjeux d’une véritable agriculture péri-urbaine. Les modalités et les moyens de cette coopération sont éminemment politiques. En RBC par exemple, de nombreux agriculteurs installés non loin de la ville lui tournent pourtant le dos en exportant leur production ailleurs en Europe. Sur le plan des déchets organiques, ces mêmes agriculteurs ne récupèrent rien des quantités faramineuses que produit la ville. Des avancées politiques sur ces sujets ne pourront être prises que grâce à l’appui d’une culture vivante telle qu’à l’œuvre avec les dynamiques d’(horti)culture urbaine. Seulement, pour ce faire, cette culture doit prendre davantage conscience des enjeux politiques d’un dialogue entre des acteurs et des institutions peu habitués à s’écouter, comme par exemple dans le dialogue inter-régional.
CONCLUSION
Avec la disparition du monde paysan du fait des « progrès » techniques et chimiques, l’agriculteur a disparu des écrans radars d’une ville qui se rêve maintenant indépendante. Alors que les effets négatifs de ce système agricole hyper-productif se font de plus en plus sentir, un besoin éthique se développe à tous les niveaux, allant jusqu’au pragmatisme de cultiver les espaces vacants des villes qui se désindustrialisent.
Pourtant, le terme d’agriculture urbaine dont on parle alors est souvent trompeur. Il donne une image caricaturale des enjeux réels de l’agriculture dont le rôle est de travailler les champs pour nourrir la population. Si la fonction productive en ville donne bien sûr des résultats intéressants et souvent désirables quand elle est associée à des projets sociaux, éducatifs et culturels, elle est moins pertinente en termes de services écologiques. Le potentiel de l’agriculture urbaine réside donc surtout dans le développement de nouvelles habitudes et réflexes vis-vis du vivant, c’est-à-dire d’une éthique et d’une esthétique. Ce changement de perception pourrait être soutenu par l’éducation, les politiques dites culturelles ou les ’institutions spirituelles’.
En ce sens, comme le souligne Fleury et Donadieu (1997), l’agriculture est clairement entrée dans le champ de la culture. Cela concerne en premier lieu la question de l’intégration des terres et des agriculteurs péri-urbains à la ville en tant que telle, invitant donc à instaurer un vrai dialogue pour développer des métabolismes urbains structurellement plus résilients. Cela demande donc de s’entendre sur ce dont on parle : l’agriculture est la culture du champ pour nourrir la population.
Car structurellement, la ville est bien dépendante de l’agriculture. La question n’est pas de savoir comment réduire ses dépendances, mais de comment en changer la nature, de planétaire à plus régionale. Alors que l’hinterland de Bruxelles exporte ses produits et que Bruxelles génère des ressources organiques, l’enjeu est de retisser des liens fonctionnels et durables entre la ville et ses territoires productifs. Cet objectif de penser et de lier plus étroitement la ville et les territoires qui lui sont historiquement liés, relève d’une dimension hautement politique, donc d’un dialogue et d’un débat par exemple inter-régionale. Il est par exemple question du retraitement des déchets de la ville par l’agriculture, de l’aménagement du droit de propriété pour permettre à de jeunes agriculteurs d’accéder à la terre (c’est par exemple le travail de l’association « terre en vue ») ou encore du développement de planifications rigoureuses et régulatrices pour permettre qu’une activité économique à faible productivité spatiale soit durable [...] car la faible valeur foncière qui en résulte exerce une puissante attraction pour la spéculation (Fleury & Donadieu, 1997).
Ces changements politiques, enfin, ne se feront qu’avec l’appui d’un changement éthique et culturel tels que le préfigurent la fantastique mobilisation autour de l’ « agriculture/horticulture urbaine ». Pour cela, il faut que ses défenseurs n’en restent pas à la question de l’éthique et de la résilience et embrassent la dimension politique – c’est-à-dire le dialogue – qui pourra, peut-être, permettre les changements structurels nécessaires. Les revendications de pouvoir cultiver en ville au nom de la résilience, bien qu’estimable, ne sont structurellement pas suffisantes : il faut aller plus loin en espérant changer le système-ville ou le « métabolisme urbain » en y intégrant son hinterland.
[1] D’après le mot d’Alphonse Allais : « Les villes devraient être construites à la campagne, l’air y est tellement plus pur ».
[2] Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral (voir bibliographie).
[3] L’émission « dans le plus simple appareil », diffusée sur Radio Campus de l’ULB et disponible en podcast sur le site du Centre d’écologie urbaine.
RÉFÉRENCES :
Blanc N. (2008). Éthique et esthétique de l’environnement. Espacestemps.net.
Boisot H. (1995). Les représentations de l’agriculture péri-urbaine : Périgny-sur-Yerres ou l’utopie d’un lieu de rencontre entre le monde rural et le monde citadin. Mémoire de DEA de l’école d’architecture de Paris-la-Villette et de l’EHESS
Brecht Bertold (1928). Denn wovon lebt der Mensch ? In : Die Dreigroschenoper : der Erstdruck.
Chapelle, G. & Jolly C.-E. (2013). Etude sur la viabilité des business modèles en agriculture urbaine dans les pays du Nord. Rapport final de la recherche réalisé pour le compte de l’Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement.
Chevau T. (2008). Politique de la ville : réorientation d’un modèle social vers un modèle économique. Territoires wallons – Séminaire de l’Académie Wallonie-Europe, mai, p. 117.
Clément G. (1997). Jardins en mouvement, friches urbaines et mécanismes de la vie. Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 39 année, bulletin n°2, Sauvages dans la ville. De l’inventaire naturaliste à l’écologie urbaine. p. 157-175.
Duby G . (1981). Histoire de la France urbaine. Paris, Seuil.
Erman S. (2014). L’alimentation pendant la 2e Guerre mondiale, article issu de l’exposition C’est le hareng qui nous a sauvé, Centre d’écologie urbaine et Etopia [en ligne], http://www.etopia.be/spip.php?article2834
Fleury A. & Vidal R. (2010). L’autosuffisance agricole des villes, une vaine utopie ? La vie des idées.fr
Fleury A. & Donadieu P. (1997). De l’agriculture péri-urbaine à l’agriculture urbaine. Le courrier de l’environnement n°31.
Felli R. (2014). Adaptation et résilience : critique de la nouvelle éthique de la politique environnementale internationale. Ethique publique [en ligne], vol. 16, n°1.
Gilligan C. (2008). Une Voix différente. Pour une éthique du care. Flammarion, Champs Essais, traduction A. Kwiatek, revue par V. Nurock. Présentation S. Laugier et P. Paperman. Titre original : In a different voice, Harvard University Press.
Gravouil F. (2011). L’esthétique environnementale et le développement durable. Bulletin Oeconomia Humana, Volume 9, numéro 5.
Kohlbrenner A. (2014). De l’engrais au déchet, des campagnes à la rivière : une histoire de Bruxelles et de ses excréments. Brussels Studies, numéro 78.
Lavedan P. (1936). Géographie des villes. Librairie Gallimard, Paris.
Lovell S.T. (2010). Multifunctional Urban Agriculture for Sustainable Land Use Planning in the United States. Sustainability. 2:2499-2522.
Mathieu N. (2004). Relations ville-campagne : quel sens, quelle évolution ? Revue POUR, Grep.
Montgomery D. R. (2007). Is agriculture eroding civilization’s foundation ?Quaternary Research Center and Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, Seattle, Washington 98195-1310, USA
Novara A. (1986). Cultura : Cicéron et l’origine de la métaphore latine de la culture. Bulletin de l’Association Guillaume Budé, p. 29-47.
Ore S., Kampelmann K. (2014). L’aquaponie : la recherche du mouvement perpétuel. Gaïa Scienza n°8, p. 23-34.
Rapport National de Belgique (2009) à inclure dans le deuxième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde en préparation par L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Rocher G. (1968). Introduction à la sociologie générale. Montréal (Québec), Canada, Éditions H.M.H., p. 211.
Wolf-Powers L. (2014). Growing food to grow cities ? The potential of agriculture foreconomic and community development in the urban United State. The Graduate Center, City University of New York.
Le Roux X., Barbault R., Baudry J., Burel F., Doussan I., Garnier E., Herzog F., Lavorel S., Lifran R., Roger-Estrade J., Sarthou J.P., Trommetter M. (éditeurs). (2008). Agriculture et biodiversité, Valoriser les synergies. Synthèse du rapport, INRA (France).